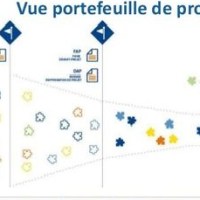Publié par riahik le
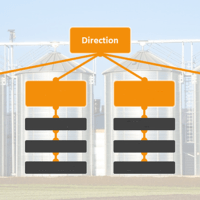
Gérer un portefeuille d’innovations dans une entreprise en silos : l'exemple de la BRED
1. Le client et sa demande

Comme toutes les banques, la BRED est confrontée à des enjeux de changement très lourds. La faiblesse des taux d’intérêt met en danger ses revenus, alors que la digitalisation ouvre des opportunités, au moins apparentes, à des acteurs dangereux.
Face à ces enjeux, le directeur général, Olivier Klein, a choisi une stratégie d’innovations à la fois défensive (réduire les coûts, améliorer les processus et les outils informatiques – ce que font toutes les autres banques) et offensive (améliorer la qualité des services rendus, et trouver de nouvelles sources de revenu – ce qui est plus original).
Il y a quelques années, il a incité son équipe à prendre des initiatives, à innover. Mais il avait le sentiment que son organisation ne permettait pas de les mettre en œuvre efficacement. D’où une mission de diagnostic puis de conception d’une organisation et d’un processus de gestion des innovations au sein de sa banque.
2. Le diagnostic
La phase de diagnostic a révélé une très belle organisation, pleine de compétences variées, et dotée d’un esprit d’équipe inhabituel pour une telle organisation. Ce qui explique probablement, avec une image et un positionnement favorable, une trajectoire de croissance que toutes les banques françaises ne connaissement pas.
En revanche, la BRED n’avait pas de culture d’innovation. C’est un phénomène classique pour une banque traditionnelle, qui est devenu un handicap dans le contexte actuel. Ceci se traduisait par trois aspects concrets.
La stratégie
La stratégie d’innovation, partie d’une stratégie générale largement exposée, était explicitée oralement, lors de grandes réunions d’équipes. Mais cette forme n’est pas propice à une transposition en actions. Les responsables de projets ne parvenaient pas à la traduire.
Ici, la stratégie d’innovation était facile à traduire en indicateurs : elle pouvait se résumer à la réduction des coûts et à la création de sources de revenus. En effet, le troisième critère, la fluidité et la satisfaction clients, se traduisait par des modifications informatiques qui réduisaient en même temps les coûts : éviter à un client de remplir un papier, c’est éviter à un salarié de le traiter manuellement.
Un des éléments clefs de la méthode FIM, la conception d’une méthode de valorisation des projets selon la stratégie, s’en trouve facilitée.
Le champ d’application
Le champ d’application de la procédure : il est très vite apparu que la banque traitait de la même manière des projets de trois natures : des projets de gain de productivité ou de revenus, des projets de mise en conformité ou de maintien en conformité, et des projets de maintien en bonnes conditions des outils.
Il était donc naturel de ne considérer comme stratégiques que les projets de la première nature. Les autres sont à considérer comme vitaux (préalable à la stratégie) mais non stratégiques. Un des avantages de cette décision est qu’un seul outil permet de valoriser, de manière comparable, tous les projets stratégiques.
La définition des innovations
Enfin, la définition de la notion d’innovation était peu claire, ce qui créait de véritables difficultés. Les cadres avaient en tête une vision « startup », d’invention et de créativité. En même temps, ils sentaient bien que le rôle de la banque n’est pas d’inventer.
La solution a consisté à définir les innovations (au sens de la stratégie d’innovation de la BRED) comme tout projet consistant à implémenter une nouvelle activité ou une nouvelle manière de faire, donc une innovation procédurale.
Le portefeuille d’innovations de l’entreprise est donc, selon cette conception, constitué des projets consistant à modifier les manières de faire de la banque, ou à en créer de nouvelles.
Cette définition a « désacralisé » la notion d’innovation, elle a rassuré les équipes qui se sont senties capables de les conduire, et qui ont ressenti la cohérence avec leur culture et leurs objectifs.
Le directeur général a validé ces trois décisions, permettant la conception du processus de gestion du portefeuille des innovations de l’entreprise.
3. Comment gérer le portefeuille d’innovations de la BRED
Dans une telle mission, il est essentiel de se couler dans la culture de l’organisation et d’utiliser au maximum l’existant, de manière à minimiser les modifications et les risques de rejet du changement. C’est largement ce qui a guidé la phase de diagnostic. Il fallait poursuivre dans cette veine pour la seconde phase.
Cela s’est traduit sur quatre aspects.
La nature de l’organisation
Une banque, surtout une banque de dépôt, est soumis à de fortes contraintes réglementaires. Elle doit garantir au régulateur le respect de règles précises et détaillées, ce qui ne peut être obtenu que par la mise en place de procédures précises et rigoureuses. La gestion des risques, autre élément essentiel, aboutit au même résultat. Si on ajoute que ses services doivent être automatisés, on aboutit forcément à ce que la théorie des organisations appelle « bureaucratie mécaniste » : une organisation basée sur des processus et des procédures formalisées, organisée en silos.

Cette structure est la seule efficace pour une banque de bonne taille. Or les bureaucraties mécanistes sont, toujours selon la théorie, généralement peu propices à innover. D’où la nécessité de résoudre ce paradoxe : comment rendre innovante une organisation mécaniste ?
Heureusement, la mission de la banque n’est pas d’inventer. Il s’agit en réalité de trouver, à l’extérieur, des idées et des solutions innovantes, de les sélectionner intelligemment, et de les intégrer efficacement. Ceci peut se faire par une procédure, rigoureuse et précise comme sait le faire la BRED. D’où la solution au paradoxe : construire une procédure à innover !
La gestion du risque et de l’incertitude
Comparés à ceux des startups, les projets d’innovations de la banque comportent assez peu d’inconnus et de risques. La principale source d’incertitude sera, en général, la pénétration du marché et/ou la vitesse d’adoption de nouveaux services par la clientèle. La BRED est bien équipée pour estimer (dans certains cas, par analogie ou avec ses experts) et pour mesurer rapidement le succès de ses actions commerciales.
Le niveau d’incertitude étant faible, il a été possible de proposer une procédure en deux étapes seulement, plus simple par exemple que celle de Photonis.
L’entrée des projets dans le processus
Dans le cas de Photonis, que je viens de citer, les techniciens produisaient des idées nouvelles en permanence. La BRED n’a pas la même culture : même si certains employés sont créatifs, les nouvelles idées ne sont pas naturellement intégrées dans un processus de développement. Il fallait donc construire, explicitement, l’entrée du portefeuille d’innovations de l’entreprise.
Après discussion avec les équipes, trois entrées ont été proposées :
- Une cellule de veille technologique et des marchés
- Un hackaton annuel, interne à la BRED
- Une réunion périodique du COMEX, de créativité
Le tri, la priorisation, des dossiers
Reste, pour compléter la procédure, à définir le contenu des dossiers projets, et la méthode de priorisation et de décisions.
La méthode de valorisation des innovations, dans notre exemple, est facile à construire. Relisez les règles que j’ai listées dans la leçon précédente (« L’estimation de la valeur d’un projet innovant. Un outil indispensable pour une gestion de portefeuille d’innovations »). Il a suffi de demander une estimation de rentabilité de chaque projet sur 3 ans, en respectant les contraintes de simplicité, de clarté, de consensus et d’identification des paramètres incertains.
Ceci suffit à imposer aux porteurs de projets de construire de bons dossiers, complets, et donne aux décideurs du COMEX une fiche claire dans laquelle tous les aspects importants sont traités.
Cette méthode parait triviale, mais c’est en fait contre-intuitif : l’estimation financière demandée est totalement différente de celles qui permettent de calculer une rentabilité de projet.
4. Conclusion
La banque a adopté, très naturellement, cette procédure, avec des modifications minimes. Elle est en cours d’implémentation, avec l’aide de sa direction de la stratégie et du développement, qui s’est approprié les éléments de la méthode FIM proposés.
Ceci résulte de l’adoption d’une procédure pour gérer le portefeuille d’innovations, qui est très conforme à la culture, aux procédures et à la qualité des équipes de la BRED.
Cette proposition, très procédurale et donc « mécanique », présente toutefois l’inconvénient de défavoriser les innovations originales, ainsi que les idées à faible enjeu (petites niches…), qui constituent probablement des opportunités importantes.
C’est pourquoi mes propositions comportaient un volet plus original, que je n’exposerai pas ici.
Comparez cette construction avec celle de Photonis. Les différences sont évidentes, et dues aux différences de stratégie, de culture et d’organisation.
En même temps, des éléments communs apparaissent : un outil de valorisation selon les règles FIM, une gestion globale du portefeuille, la définition d’étapes, la construction d’un outil qui implémente automatiquement la stratégie, la minimisation des changements à apporter.