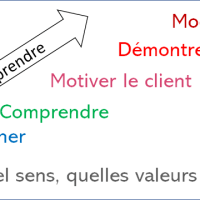Publié par riahik le

Déontologie du coach ou du conseil stratégique : mes choix, leurs conséquences sur ma pratique
Mes contacts, ma pratique, et mes questionnements personnels de coach m’ont amené à prendre conscience de l’importance et de la difficulté de la question de la déontologie du coach et du conseiller stratégique. J’ai voulu clarifier ici ma conception de cette question. Cette démarche, exigeante, s’est révélée très fructueuse.

Ce questionnement vient de mon positionnement, mais aussi de mon histoire de vie. J’en parlerais à la fin de cet exposé, car en réalité, c’est mon histoire de vie qui fonde ma déontologie. Mais, pour la bonne compréhension par le lecteur, je suivrai le plan suivant :
- Comment ai-je pris conscience de l’importance de cette question
- Comment la lecture des standards de la profession renforce le malaise
- « La déontologie du bon plombier »
- Mon histoire de vie, fondement de mon exigence.
J’ai ajouté, à la suite de ce papier, une réflexion complémentaire, qui concerne une différence dans les pratiques de coaching, selon l’origine intellectuelle des praticiens : ont-ils été formés dans une école d’origine psychanalytique, ou dans une école d’origine plutôt comportementaliste. J’ai observé une très claire différence de pratique, et de déontologie du coach, selon cette origine.
Avant de commencer mon exposé, je voudrais souligner ce qui sera le fil rouge de ce document : dans le domaine du conseil aux dirigeants et du coaching, déontologie et pratiques sont indissociables. La pratique, ses méthodes et son efficacité sont les conséquences directes de la déontologie de l’intervenant. En particulier, la déontologie a une conséquence directe sur l’efficacité, et sur la bonne relation entre l’intervenant et son client.
Comment ai-je pris conscience de l’importance de la déontologie ?
La question de la déontologie du coach et du conseiller a toujours été au cœur de ma pratique, originellement pour des raisons personnelles. Ma méthode de positionnement d’innovations sur le marché est construite sur une recherche systématisée du bénéfice client. Mon histoire de vie, développée plus bas, m’impose de faire « autant de bien que possible » à mes clients, et de développer toutes les opportunités que je détecte.
Pendant tout un temps, je me suis contenté de faire ce qui me paraissait bien. Puis, en quelques mois,
- Un de mes clients m’a raconté l’histoire d’un coach manipulateur, qui avait pris le pouvoir sur une grosse entreprise par des méthodes de manipulation psychologique
- Un autre de mes clients m’a raconté l’histoire de conseils stratégiques qui profitent de leur influence pour placer des contrats lucratifs
- Et j’ai vu deux collègues, des coachs très expérimentés et équilibrés, déraper au point de projeter leurs idées et envies sur leur relation de travail avec un client.
Je me suis alors, tout naturellement, tourné vers internet : sur une question aussi importante, je m’attendais à trouver de bonnes solutions.
Comment la lecture des standards de la profession renforce le malaise
La lecture de Wikipédia m’a montré la difficulté du sujet. Par exemple, la lecture de l’article sur la manipulation donne une sensation de flou, de confusion. Quelle limite mettre entre capacité de conviction (normale), mensonge (anormal, mais légal) et manipulation mentale (illégale et immorale) ?
La lecture des codes de déontologie de la profession de coach fut encore plus troublante. En substance, ils stipulent que « la prestation se fait dans l’intérêt du bénéficiaire ».
Une évidente tautologie. Mais alors pourquoi inscrire cette phrase, qui n’apporte aucune information ? Le code civil, fondement du droit des contrats, est beaucoup plus efficace, pourquoi ne pas s’y référer ?
Si on mentionne l’intérêt du bénéficiaire, c’est parce qu’on sait que la déontologie est un vrai problème.
Mais cette phrase est incomplète si on ne précise pas comment l’intérêt du bénéficiaire est défini. L’épaisseur de la jurisprudence qui traite de ce sujet, profession par profession, démontre la difficulté de l’exercice, et son importance (qu’est-ce qu’une offre déceptive ? Qu’un vice caché ? Quand un prestataire a-t-il satisfait à ses obligations de bonne prestation ? Quand faut-il un devis, et que doit-on trouver dedans ? Qui est responsable en cas d’imprévu ?).
On peut penser que la profession a estimé que la déontologie du coach est une question trop difficile ou controversée.
Mais ne peut-on pas aussi penser que certains professionnels se pensent seuls capables de définir ce qui est bon pour leurs clients ? Qu’ils veulent, consciemment ou non, préserver une position de « seul sachant » ?
Ne peut-on penser que certains professionnels évitent ce qui pourrait limiter leur liberté ? Qu’ils sont réticents à tout ce qui pourrait mettre leur client en position de challenger leurs résultats ?
Quelle solution ?
Dans une telle situation, le plus simple est de s’intéresser aux solutions déjà trouvées dans des contextes similaires.
Pratiquement chaque profession a ses règles déontologiques. Le médecin, l’avocat, le notaire sont des références naturelles. Mais j’ai vite compris que leur déontologie est teintée par des considérations très spécifiques (par exemple la vie pour le médecin).
Après cette lecture peu fructueuse, une idée m’a frappée. J’ai un très bon plombier, pourquoi ne pas m’en inspirer ? Et d’abord, comment se comporte-t-il ?

Quand on le consulte, il fait un devis indicatif. En fonction des besoins, il fera tout ou partie des travaux, facturés aux prix du devis indicatif. En cas de demandes imprévues, il complète son devis.
Il indique ce qu’il sait ou ne sait pas faire. Il indique ses goûts, car il ne travaille pas sans plaisir. Parfois, il accepte d’apprendre de nouvelles techniques.
Cet homme progresse en permanence. Son dialogue constant avec ses clients sur les travaux à faire institue la confiance. La solution parfaite, que j’appelle « la déontologie du bon plombier ».
Après quelques toutes petites adaptations, cela devient ma déontologie de coach et de conseiller :
- Après une première séance, dont les modalités et les objectifs ont été convenus, je propose une série de directions d’améliorations, chacune avec son estimation de temps et de coût
- Ces pistes, une fois acceptées, évolueront selon les imprévus, mais toujours de manière annoncée et estimée
- J’indique les techniques que je pratique, leurs intérêts. Si un besoin est hors de mon champ d’expertise, je le signale
- Dès le départ, j’indique ce que je cherche dans mon métier. Si je n’y trouve plus de plaisir, je peux arrêter.
- Je m’efforce que toute séance produise un résultat tangible pour le bénéficiaire.
Les objections que j’ai rencontrées
D’aucun pourrait être surpris par ce choix. Voici quelques objections que j’ai rencontrées, et mes réponses.
- Les plombiers ont une image contrastée. Certains sont excellents, d’autres moins, et un nombre significatif profite de la crédulité de leurs clients et de leur position de « sachant »
Réponse : n’est-ce pas une caractéristique des métiers de coachs et de conseil stratégiques ? N’est-il pas pertinent alors de retenir la solution des bons plombiers ?
- « Comment savoir combien de temps est nécessaire pour traiter une question stratégique, ou faire disparaitre un symptôme ? L’humain est par essence imprévisible. »
Réponse : L’humain et la stratégie d’entreprise sont en effet partiellement imprévisibles. Mais il existe des techniques dont les résultats sont, eux, raisonnablement prévisibles. N’est-il pas bon pour nos clients de les privilégier ? Quitte à segmenter une question complexe en éléments plus petits, pour les traiter un par un.
Si une démarche s’annonce longue et de durée imprévisible, n’est-il pas spécifiquement important de l’annoncer, et de faire des points réguliers ?
Depuis que je m’astreins à cette règle, j’ai toujours pu respecter mes indications de coût. C’est évident pour le conseil stratégique, c’est également vrai dans domaine plus difficile du coaching.
Surtout, cette règle impose au prestataire et à son bénéficiaire de discuter, entre client et fournisseur, de l’avancement de leur coopération. C’est extrêmement sain, en particulier parce que cela rééquilibre une relation, mettant le bénéficiaire en position haute.
- « Mais alors, il n’existe plus de place à l’imprévisible, à la découverte. »
Réponse : Bien sûr que si. C’est même essentiel, le plus gros d’un travail émerge progressivement. Pendant que l’on suit le programme, on tombe souvent sur de nouveaux sujets. Il ne reste plus qu’à les inscrire dans le programme, avec l’accord de son client.
- En expliquant tes méthodes, tu perds une partie de leur efficacité. »
Réponse : Cette remarque est vraie. Donner des indications de méthodes et de durée (le minimum selon moi) n’est pas synonyme de tout dire. Il faut en effet parfois conserver une dose de secret.
- « Je ne pourrais pas utiliser ta règle, car je n’ai que des techniques lentes et imprévisibles dans leur durée. De plus, je sais que les méthodes rapides ne traitent pas les symptômes, ils ressurgissent sous une autre forme. »
Réponse : Certains intervenants, notamment certains coachs, n’ont en effet pas d’outils rapides et efficaces dans leurs boites. Ce n’est pas une raison pour que leurs limites s’imposent à moi.
Quant à la seconde objection, je l’ai souvent entendue de la bouche de psychanalystes, ou de grandes sociétés de conseil. Elle revient à dire que seules les méthodes chères ont de la valeur. Je pense que, en tant que règle générale, elle est fausse. Ceux qui la propagent sont, pour moi suspects de prêcher pour leur paroisse, pas dans l’intérêt de leurs paroissiens ? Leur déontologie de coach ou de conseiller privilégient-elles leurs intérêts ?
Les véritables sources de ma déontologie du coach
D’aucun pourrait être surpris par ce choix. Voici quelques objections que j’ai rencontrées, et mes réponses.
- Les plombiers ont une image contrastée. Certains sont excellents, d’autres moins, et un nombre significatif profite de la crédulité de leurs clients et de leur position de « sachant »
Réponse : n’est-ce pas une caractéristique des métiers de coachs et de conseil stratégiques ? N’est-il pas pertinent alors de retenir la solution des bons plombiers ?
- « Comment savoir combien de temps est nécessaire pour traiter une question stratégique, ou faire disparaitre un symptôme ? L’humain est par essence imprévisible. »
Réponse : L’humain et la stratégie d’entreprise sont en effet partiellement imprévisibles. Mais il existe des techniques dont les résultats sont, eux, raisonnablement prévisibles. N’est-il pas bon pour nos clients de les privilégier ? Quitte à segmenter une question complexe en éléments plus petits, pour les traiter un par un.
Si une démarche s’annonce longue et de durée imprévisible, n’est-il pas spécifiquement important de l’annoncer, et de faire des points réguliers ?
Depuis que je m’astreins à cette règle, j’ai toujours pu respecter mes indications de coût. C’est évident pour le conseil stratégique, c’est également vrai dans domaine plus difficile du coaching.
Surtout, cette règle impose au prestataire et à son bénéficiaire de discuter, entre client et fournisseur, de l’avancement de leur coopération. C’est extrêmement sain, en particulier parce que cela rééquilibre une relation, mettant le bénéficiaire en position haute.
- « Mais alors, il n’existe plus de place à l’imprévisible, à la découverte. »
Réponse : Bien sûr que si. C’est même essentiel, le plus gros d’un travail émerge progressivement. Pendant que l’on suit le programme, on tombe souvent sur de nouveaux sujets. Il ne reste plus qu’à les inscrire dans le programme, avec l’accord de son client.
- En expliquant tes méthodes, tu perds une partie de leur efficacité. »
Réponse : Cette remarque est vraie. Donner des indications de méthodes et de durée (le minimum selon moi) n’est pas synonyme de tout dire. Il faut en effet parfois conserver une dose de secret.
- « Je ne pourrais pas utiliser ta règle, car je n’ai que des techniques lentes et imprévisibles dans leur durée. De plus, je sais que les méthodes rapides ne traitent pas les symptômes, ils ressurgissent sous une autre forme. »
Réponse : Certains intervenants, notamment certains coachs, n’ont en effet pas d’outils rapides et efficaces dans leurs boites. Ce n’est pas une raison pour que leurs limites s’imposent à moi.
Quant à la seconde objection, je l’ai souvent entendue de la bouche de psychanalystes, ou de grandes sociétés de conseil. Elle revient à dire que seules les méthodes chères ont de la valeur. Je pense que, en tant que règle générale, elle est fausse. Ceux qui la propagent sont, pour moi suspects de prêcher pour leur paroisse, pas dans l’intérêt de leurs paroissiens ? Leur déontologie de coach ou de conseiller privilégient-elles leurs intérêts ?
Les véritables sources de ma déontologie du coach
En fait, cette « déontologie du bon plombier » n’a que trois intérêts, mais ils sont importants.
En premier lieu, elle introduit dans la relation entre le consultant/coach et son client un élément d’équilibre. A côté de la position de sachant, haute, intrinsèque, il se met en position basse, de fournisseur face à son client.
En second lieu, elle fait peser sur le consultant/coach une exigence de transparence et d’efficacité, qui est une source d’amélioration continue. Dans mon cas, cet effet est spectaculaire.
Troisièmement, elle met le plaisir au cœur du travail. Cela allège la relation et la fluidifie. De plus, la disparition du plaisir s’avère un indicateur très avancé et fiable d’une difficulté dans l’exécution de la prestation.
Je n’ai pas mentionné, dans les intérêts de cette déontologie du coach et du conseiller, la protection de intérêts du bénéficiaire, protection qui est pourtant l’origine de ma réflexion. C’est parce que je pense que cet élément de déontologie n’est en réalité qu’un garde-fou. En premier lieu vient l’éthique du consultant. La déontologie du bon plombier n’est là que pour les quelques moments où le consultant dérape.
En ce qui me concerne, mon éthique vis-à-vis de mes clients vient de mon histoire.
Mes parents avaient appris qu’il faut élever les enfants « à la dure », sans émotion. De plus, le chemin spirituel des personnes de base 5 (ma base de l’Ennéagramme) consiste, d’abord, à apprendre à donner, à partager son savoir. Le moine avare (de son implication) doit devenir le moine généreux.
J’ai fait ce chemin. Comme toute base 5, je respecte les autres, je cherche à les comprendre et non à les juger. Je perçois leurs valeurs et leurs croyances, je comprends leurs objectifs profonds.
Aider est pour moi un enjeu réparateur : je donne ce qu’on m’a refusé quand j’étais enfant. Quand je vois quelqu’un qui en vaut la peine, ou un projet prometteur mais qui est réalisé de manière étriquée (par rapport à son potentiel), je n’ai de cesse que d’aider.
D’où mon professionnalisme dans les relations de travail, et mon besoin viscéral d’apporter quelque chose à mes clients, supérieur à ce que je leur coûte.
Origine psychanalytique ou comportementaliste, quelle conséquence sur la déontologie ?
Je connais assez bien la psychanalyse. J’en ai vécu deux. Mon père, mon frère et mon épouse y ont eu recours. Plusieurs de mes connaissances et confrères ont eu leur formation basée sur ce corpus.
Je connais également un nombre important de méthodes comportementales. J’en ai bénéficié, je les pratique, comme certains de mes confrères.
Lors de ma recherche sur la « déontologie du bon plombier », des différences marquées me sont apparues, qu’il m’a paru intéressant de partager. Je précise que ce qui suit ne résulte pas d’une recherche structurée. Je précise également qu’il existe des praticiens de qualité et des praticiens médiocre des deux côtés. Je précise enfin que les deux domaines sont riches, que les pratiques sont variées. Néanmoins, j’ai repéré une différence nette, subtile et réelle, qui semble structurante, et qui semble résulter d’une différence culturelle et intellectuelle.
Je commencerai par une comparaison utilisant les formes de l’intelligence[1]. J’en viendrai ensuite à la déontologie du bon plombier dans les deux écoles.
Origines intellectuelles et formes d’intelligence
Freud a commencé ses recherches sur un petit nombre de patients. S’agissant de maladies psychologiques, il a travaillé sur les émotions. Ses méthodes de travail, les lapsus ou les rêves, lui ont fait utiliser l’intelligence linguistique. Enfin, la découverte du transfert et son utilisation thérapeutique ont conduit à utiliser l’intelligence interpersonnelle. Trois formes d’intelligence, donc une certaine richesse.
Mais, en parallèle, les patients utilisaient leur intelligence logico-mathématique au service de leurs résistances. Et l’inconscient rejette cette forme d’intelligence. Il y a plus grave. Toute critique portée par le patient sur sa cure ou sur son thérapeute devient un symptôme, à cause des résistances et du transfert. Le thérapeute doit donc filtrer ces critiques, aussi logiques soient-elles, à travers l’intelligence interpersonnelle, en utilisant son pouvoir sur son patient.
Ceci semble avoir laissé des traces très structurelles. Pratiquement tous les praticiens d’origine psychanalytique que je connais rejettent toute mesure d’efficacité de leurs pratiques (rappelez-vous que les statistiques sont une application de l’intelligence logico-mathématique). L’un d’entre eux me disait par exemple « je n’utilise aucune méthode rapide ou efficace. Si un client veut de l’efficacité, il doit trouver un autre praticien ».
Passons maintenant à l’histoire des méthodes comportementales. Ces chercheurs ont commencé leurs travaux autour de questions d’efficacité de production dans les usines. Une application pure de l’intelligence logico-mathématique, sans la moindre considération du bien-être au travail (les émotions). Mais, dès les premières expériences, l’effet des émotions et des relations est apparu dans les chiffres. Les méthodes comportementales ont donc dans leurs gènes les notions d’efficacité et de mesure des résultats, et utilisent les formes d’intelligences émotionnelles.
La déontologie du bon plombier
La plupart des objections à la déontologie du bon plombier m’ont été opposées par des praticiens d’origine psychanalytique. Au contraire, elle parait naturelle à leurs confrères d’origine comportementaliste.
Pour un praticien d’origine psychanalytique, la déontologie du bon plombier est difficile à accepter, car elle le prive du transfert, et impose une réflexion sur l’efficacité des pratiques, que cette partie de la profession a toujours refusée.
Je vois un parallèle avec l’évolution des deux types de pratiques. En refusant les mesures de résultats, les professionnels d’origine psychanalytique se sont privé des moyens les plus efficaces d’amélioration de leurs corpus et de leurs pratiques. Même en France, où elle est encore très puissante, elle perd régulièrement de son influence et de sa légitimité, malgré les efforts de certains praticiens pour moderniser leurs méthodes.
Ceci évoque une raison essentielle de la déontologie du bon plombier : faire progresser le praticien.